Médecine et constructivisme : vers des liaisons heureuses
mercredi 21 novembre 2012 à 09:40
Paul Watzlawick
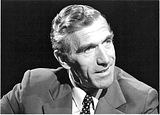

Raphaël Arditti, futur médecin, suit ce blog depuis plusieurs années. Il a ressenti, il y a environ un an, le besoin d'approfondir les savoirs que j'utilise et valorise dans mes articles. L'enseignement dispensé en médecine lui paraissait incomplet et inadapté à son fonctionnement d'alors.
Il s'est dit : « si Olivier a réussi à créer une méthode qui permet d’obtenir des résultats exceptionnels en musculation, il doit bien y avoir moyen de faire la même chose dans les études médicales. »
Il a donc acquis des connaissances, les a expérimentées, et ses progrès se sont concrétisés sous la forme d'interventions très pertinentes sous chacun de mes articles (pseudonyme : Carlo). Intéressé, je lui ai alors proposé de partager avec mes lecteurs sa vision des liens entre constructivisme, méthode et vie.
C'est cette vision que vous trouverez dans l'article ci-dessous. Le texte de Raphaël se présente à la fois comme un résumé et une interprétation de ce qu'est mon travail, sur la base de mes écrits auxquels s'ajoutent ses propres recherches.
Jean-Louis Le Moigne
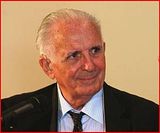
Edgar Morin
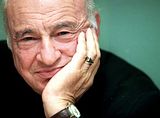
Pourquoi venir sur le blog ?
Par Raphaël Arditti
C’est vrai ça, pourquoi ? Ne serait-ce pas une perte de temps ? Ce temps qui nous est tous si précieux.
Néanmoins, on peut tout de même s’étonner de l’énergie et du temps investis par Olivier pour rédiger, compléter et diffuser gratuitement ses articles. Il doit bien y avoir quelque chose d’important…
Ces interrogations se ramènent en fait à une question centrale : quel est l’intérêt du Constructivisme pour l’individu contemporain ?
Pour répondre à cette question, j’aimerais tout d’abord faire le point sur notre situation actuelle. Puis, une fois ce cadre établi, l’inadéquation de la musculation traditionnelle ainsi que son nécessaire dépassement par la musculation constructiviste (Méthode Lafay), apparaitront plus aisément. Enfin, en m’appuyant sur les éléments introduits dans la 2nde partie, j’essaierais de montrer, de manière plus générale, en quoi les concepts constructivistes peuvent s’avérer particulièrement précieux pour chacun d’entre nous.
Bonne lecture à toutes et à tous.
Ernst von Glasersfeld

I. La situation de l’individu contemporain : l’exigence d’autonomie
L’élément probablement le plus marquant de notre situation actuelle, est la possibilité que nous avons de nous gérer nous-mêmes. Etre le capitaine de son propre navire, donner le cap, est en effet une avancée particulièrement récente.
« Pendant des millénaires, les individus n’ont pas été en mesure de « se réaliser ». Ils étaient soumis à un destin, dépendant de leur lieu de naissance, de leur milieu social et de la profession exercée par les parents. Un fils d’agriculteur devenait la plupart du temps agriculteur, un commerçant devenait commerçant, etc. » (Méthode de nutrition p.13).
Nous sommes donc contraint, dans tous les domaines de notre existence, d’orienter notre embarcation dans une direction plutôt qu’une autre, d’apporter des solutions adéquates et personnalisées aux nombreux problèmes qui nous assaillent quotidiennement.
« L’athlète du quotidien a fort à faire, il doit s’accomplir professionnellement, socialement et personnellement. Et ces trois modalités de l’épanouissement individuel sont très profondément imbriquées. » (Méthode de nutrition p.33)
A travers cette exigence d’autonomie, c’est notre identité qui est en jeu, car nos actions à la fois traduisent et construisent ce que nous sommes. L’individu contemporain est sommé de se construire lui-même.
Heinz Von Foerster
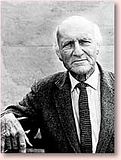
II. Les outils à disposition de l’individu contemporain : l’exemple de la musculation
Dans ce contexte, la musculation semble permettre, par la construction du corps, de répondre en partie à l’exigence contemporaine de construction de soi.
Mais qu’en est-il vraiment ?
Lorsqu’on tourne notre regard vers la musculation telle qu’elle est pratiquée traditionnellement, on constate que les entraînements nombreux, longs, épuisants, ne laissent au pratiquant ni le temps ni l’énergie pour se consacrer à de nombreuses autres activités. Cette situation pose problème à l’individu contemporain, sommé qu’il est de se réaliser dans tous les domaines (personnels, professionnels et sociaux). Il ne peut donc plus se payer le luxe d’être totalement absorbé par une activité, de dilapider tout son temps et son énergie dans un secteur très précis de son existence.
Par conséquent, la musculation, telle qu’elle est envisagée habituellement, apparaît inadaptée au contexte actuel.
On a le sentiment qu’elle n’est plus considérée comme un moyen pour se construire, mais comme une fin en soi, le but étant d’en faire toujours plus.
La question qui se pose alors, est de savoir si cette finalité peut être questionnée, critiquée. S’il s’agit d’une finalité absolue, éternelle, ou bien d’une finalité élaborée par les hommes et donc potentiellement modifiable.
C’est à ce moment là que le Constructivisme entre en scène, car selon lui, la compréhension que nous avons du monde (ici, de la musculation) est construite. Cela signifie donc que le sens de la musculation, sa finalité, peut être réévalué, réadapté au contexte actuel.
Aujourd’hui, nous ne pouvons plus nous permettre de pratiquer une musculation aliénante, qui grignoterait toutes nos autres sphères d’activité, nous enfermant ainsi dans le culte du corps. Il nous faut, bien au contraire, une musculation qui subordonne la construction du corps à la construction de soi, qui nous laisse les ressources nécessaires à la réalisation de notre développement global, et qui même, y contribue.
La finalité de la musculation devient le mens sana in corpore sano.
« Je présente régulièrement la méthode comme "le meilleur compromis", car c'est comme ceci que je l'ai voulue et conçue pendant mes quinze années de recherche : une polyvalence athlétique obtenue en un minimum de temps de pratique. Une grande force, endurance, puissance, souplesse, détente, avec seulement 2 séances d'entraînement hebdomadaires; et même un gros volume musculaire avec 3 séances hebdomadaires et une alimentation hypercalorique. » (Le meilleur compromis 10/07/11)
A présent que la finalité de la musculation est clairement posée, il s’agira de produire un entraînement à même de concrétiser cette ambition. Concernant l’outil à utiliser, le poids du corps s’impose comme une évidence, car il est peu traumatisant pour l’organisme (économie d’énergie) et peut être utilisé n’importe où (économie de temps, d’argent et d’espace).
Les séances traditionnelles sont particulièrement longues, car elles se fondent sur une vision analytique du corps humain : les différents muscles sont isolés et exercés les uns après les autres, séquentiellement. De même, les qualités athlétiques sont strictement distinguées (endurance, résistance, force, détente etc.) et exercées spécifiquement.
Ainsi, plus l’on désirera exercer un nombre important de muscles ou de qualités athlétiques, plus les séances seront nombreuses et étirées dans le temps. Cette façon de procéder est très liée à la finalité de la musculation classique. A présent que notre projet est la polyvalence athlétique, obtenue de manière la plus économique possible, on cherchera à créer un système, où exercices, temps de repos et nombre de séries joueront le rôle d’éléments actifs, agencés rationnellement dans le but de faire émerger les qualités athlétiques recherchées. Les programmes ainsi obtenus, devront être par la suite agencés de manière progressive, afin d’amener sans encombre le pratiquant jusqu’à son objectif.
Non seulement la musculation traditionnelle dissèque le corps humain, mais elle clive également l’individu, l’esprit cherchant à soumettre le corps dans une confrontation héroïque et énergivore entre soi et soi. On préfèrera substituer à cette attitude, trop gourmande en énergie, la coopération avec le monde, avec les autres et avec soi-même (concept d’efficience). La structuration de l’entraînement doit ainsi permettre au pratiquant de contourner les obstacles qui se dresseront sur son chemin. La création d’espaces internet (forums, blogs) dédiés à la pratique de la Méthode, autorisera entraide et partage.
Enfin, ce système devra pouvoir être rapidement mis en pratique par le pratiquant (économie de temps et d’énergie), ainsi que présenter suffisamment de souplesse pour être en mesure de s’adapter à l’univers particulier de chaque pratiquant, ainsi qu’à ses objectifs propres, en terme de développement musculaire et de condition physique.
« Le succès de ma méthode, les remous qu’elle a suscités, les copies qu’elle peut inspirer, proviennent moins du fait que ce soit une méthode au poids de corps que le renversement radical des conceptions qu’elle a engendré en musculation.
Le renversement est effectivement radical : le délai entre le début de l’apprentissage et l’action efficace est considérablement réduit dans ma méthode. Le pratiquant dispose d’un ensemble d’informations l’emmenant directement vers l’action. Il change. » (Turbo p. 10)
Ainsi, en postulant que notre compréhension du monde est construite, et que cette construction se réalise par une remise en contexte de l’objet d’étude, le Constructivisme nous a permis de penser et d’établir une culture physique répondant aux exigences contemporaines.
Cloe Madanes

III. Penser nos actions grâce au Constructivisme
En m’appuyant sur les éléments introduits dans la 2nd partie, j’aimerais montrer ici, de manière plus générale, en quoi les concepts constructivistes peuvent s’avérer si utiles à chacun d’entre nous ; notamment lorsque nous sommes confrontés à une situation d’échec.
Dans ce cas, nous avons le plus souvent tendance à nous acharner, à revenir à la charge encore et encore, en pensant finalement l’emporter.
Comment expliquer cette attitude ?
Certes, nos sociétés occidentales nourrissent la croyance selon laquelle la réussite doit s’accompagner de nombreuses souffrances (no pain no gain), mais il y a également des raisons plus profondes.
En effet, toute action se base sur une présupposition, sur un fond culturel qui informe sur le pourquoi et le comment de cette action ; qui lui donne son sens.
« La quête première de l’homme, dès lors qu’il a pu construire une adaptation à l’environnement qui soit favorable à sa survie, est celle du sens. Nous avons besoin de comprendre le monde et d’être compris par lui. » (Méthode de nutrition p. 28)
Si nous ne prenons pas conscience de ce fond culturel qui détermine nos actions, nous sommes condamnés au « toujours plus de la même chose ».
« L'image est donc celle d'un cercle infernal dont il faut sortir, et cela se fait en étant créatif, ouvert, en réfléchissant à nos conditionnements. » (Répéter jusqu’à en mourir 18/01/12)
Pour cela, le Constructivisme va s’avérer déterminant. En effet, celui-ci affirme que ce fond culturel est construit par les hommes et non donné, évident ou absolu ; il peut donc être modifié, déconstruit puis reconstruit.
Il s’agira, lors de la première étape (déconstruction), de prendre du recul sur la situation, en identifiant le pourquoi (but) et le comment (moyens) de notre action.
Suite à cette prise de conscience, deux types de modification pourront être envisagées.
Un changement superficiel : la finalité, le sens de notre action n’est pas modifié, car jugé approprié à la situation. Seuls les moyens permettant d’y parvenir seront réajustés.
Un changement en profondeur : la finalité de notre action n’est pas jugée adaptée au contexte, elle doit donc être modifiée.
Envisager que le sens de notre action n’est pas adapté au contexte, c’est donc inscrire cette activité dans un ensemble plus vaste. C’est comprendre cette action non pas en elle-même, comme une fin en soi, mais comme un moyen au service d’une finalité plus vaste.
On comprend donc que, pour l’individu contemporain, toutes ses activités doivent être subordonnées à un projet de vie global. Elles doivent jouer le rôle d’éléments actifs, agencés rationnellement dans un but : la réussite d’un projet de vie.
Quels sont les bénéfices d’une telle modélisation ?
Tout d’abord, ce projet de vie va jouer pour nous le rôle d’un phare : grâce à lui, nous allons pouvoir orienter plus aisément notre embarcation. Les prises de décision quotidienne s’en trouveront facilitées.
L’organisation rationnelle des activités sélectionnées, permet de penser les rapports entre ces activités : comment les coordonner au mieux afin d’éviter les conflits, les frottements, les pertes d’énergie ? Le concept d’efficience s’avère alors pensable et nécessaire. Il s’agira de réaliser l’association la plus productive possible, celle qui vous permettra d’atteindre aisément votre objectif, sans perte ni fracas.
« L'efficience est de l'ordre de l'invisible ou du presque invisible. L'efficience cause un minimum de friction avec le réel. Elle procède d'une logique de coopération et fonctionne suite à une douce et habile mise en condition (de légères actions) en amont. L'efficience ne rejette ni ne nie l'efficacité, elle l'intègre, mais en minorant sa place. Elle a pour but (pour essence?) de réduire les périodes d'affrontement direct. Elle est volonté de transformation silencieuse. » (De l’efficacité à l’efficience : la nouvelle voie du muscle 15/02/12)
N’avez-vous jamais entendu dire : « Attend, c’est normal qu’il réussisse ce qu’il entreprend ! Tu as vu dans quelles conditions il est ?! » ?
Giorgio Nardone

Conclusion
Résumons brièvement : l’individu contemporain est soumis à une exigence d’autonomie, et il semblerait que le Constructivisme s’avère particulièrement adapté pour y répondre. En effet, celui-ci permet
De critiquer/dépasser les solutions inadéquates
De prendre plus aisément ses décisions, par la formation d’un projet de vie global
D’atteindre plus aisément ses objectifs, grâce à une logique de coopération (efficience).
Pour finir, j’aimerais replacer cet article dans la continuité de ceux rédigés par Olivier, en réalisant quelques ouvertures sur des concepts appelés à être développés prochainement, notamment dans « Discours sur les méthodes ».
Nous avons vu qu’envisager les relations entre nos différentes sphères d’activité permettait de mieux les coordonner, afin d’atteindre plus aisément notre objectif de vie. Mais nous ne sommes pas seul. Il y a autour de nous des gens qui cherchent également à réussir leur propre projet de vie. C’est pourquoi un bon projet de vie, est un projet qui prend en compte les projets de ceux qui nous entourent, qui se subordonne lui-même à un projet plus global, au niveau de la société. A partir de là, la coopération avec les autres devient possible et même salvatrice.
Mais comment coopérer au mieux avec autrui ?
C’est la communication qui nous relie les uns aux autres. Ainsi, si nous souhaitons obtenir des échanges de qualité, il nous faut disposer d’un langage souple, suffisamment riche pour pouvoir s’adapter à des interlocuteurs divers, à des contextes divers. Il nous faut un langage complexe.
La société demande à l’individu d’être compétent dans de nombreux domaines. Néanmoins, même si les outils constructivistes s’avèrent particulièrement libérateur, il n’est pas possible d’être un spécialiste en tout.
« Ce qui va nous manquer, ce sont des méthodes, c’est-à-dire des outils capables de nous prendre en charge jusqu’à l’obtention du but final, en un minimum de temps. Ceci progressivement, sans nous étouffer » (Méthode de nutrition p.31)
Par conséquent, creuser le concept de méthode, l’approfondir, permettra à chacun de se libérer et de libérer autrui.
Françoise Kourilsky

Siegfried Schmidt

Posté dans Philosophie
Olivier Lafay




le mercredi 21 novembre 2012 à 12:39
Wow !
Incroyablement enrichissant :D
le mercredi 21 novembre 2012 à 13:28
Très bon post qui résume très bien à mon sens le but de la méthode ainsi que sa relation au constructivisme, j'ai apprécier également lorsque que vous parlez d'entraide dans votre conclusion...
J'espère qu'au fil du temps, de part ses évolutions, la méthode conservera cet esprit "philanthropique" qui la caractérise.
le mercredi 21 novembre 2012 à 13:35
Comment créer le bon chemin jusqu'au but final auto défini ? faut il avoir une intelligence supérieur ou et un niveau de connaissances élevés? Si oui il y aurait comme un non sens vu que c'est par l'action que tout est censé commencer..Quel est le meilleur moyen d'appliquer le constructivisme dans une activitée quelconque pour l' individu contemporain ?
le mercredi 21 novembre 2012 à 13:38
l'individu contemporain peut il créer sa propre méthode ? Le temps passé à la créer fait que c'est par la théorie que je vais entreprendre ma démarche pour commencer,au lieu de l'action,à moins que quelqu'un le fasse pour moi ...
le mercredi 21 novembre 2012 à 14:07
le mercredi 21 novembre 2012 à 14:10
Vraiment très intéressant.
Bravo
le mercredi 21 novembre 2012 à 18:38
Intéressant même si rien de très neuf. Cependant,où se situe le lien avec l'enseignement dispensé en médecine?
Quelles solutions pour "obtenir des résultats exceptionnels dans les études médicales " en s'inspirant de la méthode , si ce n'est "acquérir des connaissances et les expérimenter" ? Quelles sont ces "liaisons heureuses" annoncées dans le titre?
En quoi l'enseignement dispensé en médecine paraissait-il inadapté et incomplet? Trop de savoirs transmis et non construits? En quoi le constructivisme l'aurait-il amélioré?
Ces questions d'ordre pédagogique m'intéressent.
le mercredi 21 novembre 2012 à 19:40
2 - quelle est ton interprétation de "vers des liaisons heureuses"?
le mercredi 21 novembre 2012 à 20:06
Pilou Pilou, si l'étudiant doit fournir une quantité de travail très importante pour que cela se traduise finalement par des compétences cliniques modestes, on peut penser que l'enseignement est inadapté.
Le problème, c'est que les études médicales ne sont plus pensées en relation avec la pratique clinique : on cherche simplement à en savoir le plus possible sur le corps humain. Pour cela, on va isoler chaque organe afin de l'étudier à fond (un peu de coeur en 2e année, un peu de foie en 3e année etc.).
Non seulement l'étudiant va patauger dans la pratique, mais ses études vont également lui prendre tous son temps et son énergie, ce qui aura des répercussions nuisibles sur le reste de ses activités. De plus, seuls ceux qui disposent de ressources importantes et sont prêts à les investir massivement dans leurs études peuvent espérer s’en sortir (élitisme).
Repenser les études médicales à l'aide du Constructivisme, c'est donc dans un premier temps s'interroger sur la finalité de ces études. Puis, sélectionner les connaissances nécessaires et les organiser en système.
PS : je me suis cantonné à l'essentiel, si tu souhaites que je développe un point n'hésite pas :-)
le mercredi 21 novembre 2012 à 20:35
1) "rien de très neuf",dans le sens où l'article ne fait "que" résumer votre travail, sans apporter de grande nouveauté.
2) "vers des liaisons heureuses": le lien "heureux" entre médecine (ou plutôt études en médecine) et constructivisme n'est pas explicité, à peine évoqué dans l'introduction. Le titre et le contenu de l'article sont à mon sens en décalage.
D'où mon interrogation.
le mercredi 21 novembre 2012 à 20:57
Ce qui est intéressant, c'est que la phytothérapie cultive depuis sa découverte (approximativement la naissance du premier ancêtre de l'homme actuel) l'efficience au niveau des remèdes prescrit. Ce qui n'est pour la plupart du temps, pas le cas de la médecine moderne. Je conseille donc a l'auteur de cet article de s'inspirer aussi de la phytothérapie pour aiguiser encore plus ces réflexions sur la médecine, hormis si ce n'est déjà fait.
le mercredi 21 novembre 2012 à 21:07
un vrai plaisir de lecture, et quand je lis cet article, je peux faire le lien entre l'individu contemporain et le constructivisme sur un ensemble de projets de vie et qui peuvent être pour chacun de nous la musculation, le travail, une maison etc..plus qu'un projet global, un projet ou un esprit de vie si bien mentionné.
prenez du recul, visualisez et reconstruisez l'ensemble pour une meilleure efficience.
le mercredi 21 novembre 2012 à 22:07
Pilou Pilou, l'allusion aux études de médecine permet de comprendre pourquoi j'ai cherché à approfondir ma compréhension du constructivisme, et permet également de montrer que celui-ci peut être utilisé pour penser toutes nos actions, qu'il s'agisse d'études, de musculation ou d'autres activités.
Mon article n'a pas vocation à combler les lacunes ou à développer le propos d'Olivier. Il ne s'agit que d'un élément supplémentaire pour aider celles et ceux qui souhaitent s'approprier les savoirs constructivistes.
Jérémy, merci d'avoir attiré mon attention sur ce point :-)
le jeudi 22 novembre 2012 à 08:51
Prendre la direction de liaisons heureuses signifie donc que soit ces liaisons sont déjà existantes mais hors-champ, soit en voie de développement.
Et cet article indique que les deux sont possible. Il s'agit du témoignage d'un futur médecin, qui entame ces liaisons entre médecine et constructivisme et nous décrit une toute première étape, la plus générale, où la prise de conscience, la compréhension du cadre, permettent d'éclairer le chemin à suivre.
Raphaël va dans un sens, celui des liaisons heureuses, qui pourraient permettre de résoudre sa problématique. Peut-être bien que de prochains articles lui donneront l'occasion de partager avec nous son avancée dans la formation de ces liaisons au niveau du cadre strict de la médecine...
le jeudi 22 novembre 2012 à 11:54
Cet article est vraiment très intéressant (à la différence des oeuvres de Pilou-Pilou, le critique concon).
J'aime vraiment bien l'approche et l'idée de l'interaction Moi/Autrui, la prise en considération de l'autre dans la construction d'un projet personnel pour qu'il devienne projet social.
"Ainsi, si nous souhaitons obtenir des échanges de qualité, il nous faut disposer d’un langage souple, suffisamment riche pour pouvoir s’adapter à des interlocuteurs divers, à des contextes divers. Il nous faut un langage complexe."
Cette phrase m'a beaucoup intéressé (ayant à côtoyer des univers très différents et entre lesquels il n'existe aucune forme de communication). Un langage riche et souple est un facilitateur social tant que la maitrise d'un vocabulaire étendu ne sert pas uniquement l'égo de celui qui le maitrise (un peu comme les règles de savoir-vivre).
Evidemment : une limite. Tout cela est bien beau mais que fait-on de Pilou-Pilou ? Il faudra toujours conserver les tartes dans la figure à un moment de la thérapie.
le jeudi 22 novembre 2012 à 11:57
Le problème que je rencontre dans la vie de tous les jours (études, milieu professionnel, sport...) c'est que bien que certaines personnes ont une vision novatrice/alternative (efficiente en l'occurrence), les choses n'évoluent pas/peu.
En effet, même si on possède les outils pour changer se qui existe, on est conditionné par un cadre.
Ce cadre "construit" semble immuable.
Pour changer concrètement des attitudes, des façon de faire, des pensées "No pain no gain" (ou le culte du chemin le moins efficient mais le plus "héroïque"...) la tâche est difficile.
Alors lorsque l'on cherche à instiller des bribes d'idées nouvelles on est perçu comme une brebis galeuse.
Le fait qu'Olivier soit constamment attaqué sur ses travaux illustre cette phrase.
Ici pour prendre l'exemple des études de médecine, il semble bien que l'apprentissage est inadapté. Mais inadapté à quoi?
- à la préparation du diplôme?
- ou à la préparation du futur professionnel?
Le but des études est de:
- préparer un diplôme?
- ou de former un MED?
La formation est à mon sens adéquat pour avoir son diplôme, et c'est se qu'on demande à un étudiant, avoir des diplômes...
Mais cette formation fait-elle de lui un bon professionnel? Raphaël à donné son point de vue plus haut et je le rejoint.
Le but de cette formation est donc à repensé. C'est le même problème pour le BAC et le bachotage, et pour bien d'autre filières.
On est tous conditionné par un cadre, celui de la société (construit par elle), des études, du travail... Pour moi le frein est là.
Comment déconstruire?
le jeudi 22 novembre 2012 à 13:54
Comme Spooner, j'ai beaucoup aimé la fin de l'article qui aborde les interactions entre les différents projets personnels.
Pour moi, on ne peut pas être heureux en se réalisant uniquement soi-même, on ne peut être heureux uniquement dans un monde où tous les autres le sont :
En effet, soit on est un minimum altruiste et voir les autres souffrir gâche notre bonheur, soit on est égoïste et les malheureux risquent de gâcher notre bonheur par leur mauvaise humeur, leur violence, leur jalousie....dans tout les cas, impossible d'y échapper!
J'espère qu'on parlera de plus en plus de ce sujet. (le rapport à autrui et comment créer un système d'entraide).
En tout cas, merci à Carlo pour ce très bon article rédigé de façon très accessible (je dis ça car parfois tes commentaires sont un peu trop complexes pour mon modeste niveau, là c'est super pédagogique et clair).
Bonne continuation!
le jeudi 22 novembre 2012 à 15:11
Spooner, je suis tout à fait d'accord avec ton commentaire. Le problème que je rencontre souvent et auquel tu as sûrement dû être confronté, c'est la tension qu'on peut ressentir entre la volonté de s'exprimer dans un langage compréhensible pour son interlocuteur, et la nécessité d'employer certains mots pour exprimer une idée.
Bien souvent, on se rend compte qu'il faudrait passer par de multiples étapes intermédiaires pour que le message soit compris, et la conversation reste au point mort ce qui est dommageable pour tous les participants...
Jean-Paul, je suis d'accord qu'on peut être mal perçu lorsque l'on souhaite faire évoluer une situation, mais bien souvent, les gens qui se disent insatisfaits n'ont pas suffisamment de recul pour proposer quelque chose d'intéressant. Personnellement, je n'aurais jamais eu l'idée de chercher du côté du Constructivisme si la Méthode n'existait pas, et même là, j'ai mis énormément de temps à comprendre le peu que je sais aujourd'hui.
Concernant la manière de faire évoluer un cadre socialement construit, on retombe sur la distinction efficacité/efficience. Faut-il rentrer en conflit avec ce cadre, ou bien chercher à le faire évoluer en douceur, en l'infiltrant de l'intérieur jusqu'à l'envahir complètement ?
Insane in the brain, merci pour ton commentaire ! Je passe pas mal de temps à rédiger mes messages afin qu'il soit le plus clair possible, donc si ce n'est pas le cas, il faut me le dire !! :-D
le jeudi 22 novembre 2012 à 21:43
@Raphael
Tout d'abord merci pour la clarté de ta réponse.
Cependant : "Repenser les études médicales à l'aide du Constructivisme, c'est donc dans un premier temps s'interroger sur la finalité de ces études. Puis, sélectionner les connaissances nécessaires et les organiser en système. "
Je ne perçois pas en quoi en appliquant ce principe, on pourra repenser les études (qu'elles soient médicales ou pas d'ailleurs). Lors de la conception des programmes quelles que soient les filières, les finalités des études sont clarifiées. Les hauts fonctionnaires rédigeant les programmes d'enseignement ont clairement à l'esprit qu'en médecine, on forme des médecins et en STAPS des profs d'EPS.
Les connaissances nécessaires sont également mises en évidence et traduites en contenus d'enseignement. C'est ce que l'on nomme (ou que CHEVALLARD nomme) l'étape de la transposition didactique (passer du savoir savant au savoir enseigné).
Elles sont par la suite hiérarchisées et organisées sur l'ensemble du cursus, de l'année, du trimestre et de la période.
En ce sens, je ne saisis pas en quoi adopter une attitude constructiviste telle que tu la décris permettrait de réformer davantage le systéme scolaire(je généralise volontairement).
Cependant, les concepteurs des programmes, même s'ils réfléchissent sur les objectifs, analysent et organisent les connaissances, sont coupés des réalités du terrain. De ce fait, je te rejoins quand tu effectues le constat que les contenus sont très souvent en inadéquation avec l'objectif final des études.
Il faut donc (et cela est courant dans les milieux primaires et secondaires), refonder les programmes et modifier les méthodes d'enseignement. Mais cela est légion dans l'éducation nationale et ce, depuis le début de la V eme République (où l'on va de "réforme des programmes" en" refonte du système" tous les quatre ou cinq ans...).
D'autre part,"Non seulement l'étudiant va patauger dans la pratique, mais ses études vont également lui prendre tous son temps et son énergie, ce qui aura des répercussions nuisibles sur le reste de ses activités".
Je serais tenté de te répondre que oui, lorqu'on étudie et souhaite réussir brillament, le travail devient une priorité absolue. Le reste des activités est totalement secondaire quitte à faire des sacrifices. Les études deviennent donc effectivement "chronophages et énergivores". Mais l'on parle ici de travail scolaire, permettant d'aboutir à l'obtention d'un diplôme ou d'un concours, précieux sésame pour la vie active. On ne parle plus de musculation et le parallèle ne peut s'effectuer.
Les notions de travail et de mérite sont actuellement réintégrées petit à petit dans nos écoles, après avoir laissé croire pendant des années aux élèves que le savoir pouvait s'acquérir sans effort ni labeur. Pour apprendre et réussir il faut travailler, beaucoup, souvent. C'est un fait. Dans un concours, les meilleurs sont pris, c'est un fait. Les dérives pédagogistes des trentes dernières années ont désacralisé le savoir, ruiné l'autorité des enseignants. Mettre l'élève au centre du système, utiliser ses propres représentations, lui faire découvrir le savoir sans le lui transmettre,ne jamais le contraindre et proposer des activités pseudo ludiques, utiliser des methodes de lecture globale et bannir les syllabiques, enseigner l'EPS sans prise de performance ni scores chiffrés, considérer l'école comme un lieu de vie et pas de travail... Autant de principes propres à une pédagogie dans laquelle le travail et la connaissance étaient relayés au second plan.
A la source de cette dérive, les théories pompeuses de Philippe MEIRIEU s'inspirant directement des théories constructivistes de Piaget, Wallon et Vigotsky...
le vendredi 23 novembre 2012 à 01:49
ok, merci Olivier, et merci Carlo pour cette nourriture donnée gracieusement pour nous aider à devenirs meilleurs et plus libres.Je le comprend d'autant plus en se qui concerne la musculation car je viens de m'abonner dans une salle pour une période d'un mois histoire de m'en faire ma propre idée.Sa commence mal déja c'est cher 85 euro le mois mais bon ils on été gentil d'habitude c'est 150 ;) ...les entrainements comme cités dans l'article sont hyper longs..et dire qu'il y en a qui disent que le protéo systeme est une secte et que la fonte rend libre ..et je me dit aujourd hui que meme si je me dévellopait mieux avec la fonte (se qui m'étonnerai mais bon ..)ba je veux pas que sà soit une finalitée,je veux que la muscu soit un élément qui contribut à mon dévellopement professionnel social et personnel,encore merci
le vendredi 23 novembre 2012 à 10:00
@ Pilou-Pilou :
Meirieu et sa bande font de l'éducation un monde où la bêtise doit être enseignée partout pour que les sous-doués ne se sentent pas exclus.
Olivier Lafay met à la portée de ceux qui étaient autrefois considérés non doués génétiquement une méthode leur permettant de dépasser une "élite" dopée.
CONCLUSION : ON NE DOIT PAS PARLER DU MEME CONSTRUCTIVISME.
le vendredi 23 novembre 2012 à 10:47
"le travail devient une priorité absolue. Le reste des activités est totalement secondaire quitte à faire des sacrifices. Les études deviennent donc effectivement "chronophages et énergivores". Mais l'on parle ici de travail scolaire, permettant d'aboutir à l'obtention d'un diplôme ou d'un concours, précieux sésame pour la vie active. On ne parle plus de musculation et le parallèle ne peut s'effectuer."
No pain no gain hein?
Avant tu ne voulais pas qu'on parle d'efficience en musculation et maintenant tu veux...cantonner l'efficience à la musculation.
On avance lentement mais sûrement.
Et bien évidemment, la dernière phrase que je cite est une affirmation qui doit être prise comme vérité absolue et n'est donc étayée par aucun argument.
Pas d'arguments et un texte globalement incohérent, comme à ton habitude.
Le minimum avant de commenter un article est de le lire.
Sinon, tu pourrais mettre en application ce que tu nous promettais en septembre:
"Je ne suis pas "efficient",pas "constructiviste", mais je fais des dips et des tractions, je pousse de la saleté de fonte, je mange des oeufs et me tape des daubes de sanglier arrosées de vin rouge.. Je suis peut être médiocre et peu intellectuel, mais je suis musclé et totalement épanoui... Je ne viendrai plus sur ce blog ennuyeux et pompeux, je ne vous lirai plus, je vous laisserai propager la bonne parole"
Ne pas lire, tu le fais déjà, il ne te reste plus qu'à ne pas venir. Tu gagneras du temps, de l'énergie que tu pourras utiliser pour d'autres activités.
Oublie le no pain no gain et fais un premier pas vers l'efficience...
le vendredi 23 novembre 2012 à 11:14
Il y a le constructivisme épistémologique (Ernst von Glasersfeld, Jean-Louis Le Moigne, Edgar Morin, Heinz von Foerster, Siegfried Schmidt).
Le constructivisme thérapeutique (Paul Watzlawick, Giorgio Nardone, Weakland, Madanes, Zeig, Kourilsky, etc).
Et il y a le constructivisme pédagogique (développé et appliqué à l'école). Celui-ci est inspiré du constructivisme épistémologique, comme l'est le constructivisme thérapeutique, et a ses spécificités.
Mon travail est très largement inspiré du constructivisme épistémologique et de ses applications thérapeutiques, alors que j'ai peu exploré le constructivisme appliqué au milieu scolaire.
En gros : la Méthode Lafay est (en partie) une application du constructivisme, avec ses spécificités, comme le constructivisme "scolaire" en est une autre. Nous puisons à la même source, avec un parcours forcément différent. Il y a bien d'autres références dans mon travail, qui en font sa spécificité. J'en ai d'ailleurs déjà cité beaucoup et je vais continuer à en citer. Le constructivisme est pour moi un (très important) point de départ.
Je ne crache cependant pas sur le constructivisme "scolaire", car celui-ci est bien évidemment diabolisé, bien souvent par des ânes, des politiciens habiles à tromper le peuple, et des réactionnaires confirmés. On met sur le dos des "constructivistes scolaires" la faillite de l'école, comme on l'a aussi fait avec la méthode de lecture globale, etc. La société va mal, on montre du doigt l'école et les théoriciens de sa pédagogie. C'est banal.
Il suffit de lire Alain Ehrenberg pour comprendre que le retour aux bonnes vieilles valeurs et à l'Etat républicain, tout en voulant conserver l'exigence contemporaine d'autonomie, est un non-sens, un paradoxe dont la solution ne peut être qu'un dépassement des oppositions en terme de pédagogie appliquée. Et, un peu de bon sens permet de voir que ce dépassement est déjà à l'oeuvre (a toujours été à l'oeuvre) dans le milieu scolaire, ne serait-ce que parce que pour faire ce que préconise ce "constructivisme scolaire", il faut être un enseignant extrêmement bien formé et très compétent... Les enseignants mélangent donc, pour la plupart, les conceptions.
La souffrance sociale doit trouver ses origines ailleurs. Un peu plus haut, un peu plus loin : l'Etat républicain a été liquidé par les politiques et par le peuple, dans l'optique du développement de l'autonomie, de la responsabilité individuelle, du choix "libre" de chacun, comme l'explique très bien Alain Ehrenberg. Il n'est donc pas prêt de revenir.
le vendredi 23 novembre 2012 à 13:09
@Spooner : Ta remarque sur Meirieu montre ta connaissance approfondie du milieu éducatif. Je n'étais pas au courant que l'on enseignait "la bêtise partout"... Les problèmes qu'ont introduit Meirieu, Bourdieu ou autre Bentolila ne résident pas dans ce qu'on enseigne (la bêtise pour toi) mais comment on l'enseigne.
Effectivement il existe diverses approches du constructivisme. Je traite pour ma part du constructivisme appliqué à la pédagogie, et de ses limites évidentes.
Quant aux tartes dans la figure,tu devrais y réfléchir à deux fois...
@Shiver : Es tu en désaccord profond avec la phrase que tu cites en début de commentaire? Ne considères tu pas que le travail reste une valeur fondatrice de notre société? N'acceptes tu pas l'idée établie que c'est par le travail que s'obtiennent les résultats, et que le parallèle entre pratique de la musculation et études est inadéquat? Pourqoi revenir sans cesse au no pain no gain.¨Par définition, un métier est chronophage et énergivore. " Plus je fais d'heures sups, plus je vais gagner... " (sans allusion politique aucune...). A moins que tu aies la solution pour devenir médecin en bossant 3 séances d'une heure par semaine et en gardant tout le temps restant pour mon épanouissement personnel! Oublie un peu l'efficience et fais un pas vers le discernement.
De plus, pourrais tu pointer les incohérences de mon commentaire?
@ Lafay : "La souffrance sociale doit trouver ses origines ailleurs. Un peu plus haut, un peu plus loin : l'Etat républicain a été liquidé par les politiques et par le peuple, dans l'optique du développement de l'autonomie, de la responsabilité individuelle, du choix "libre" de chacun, comme l'explique très bien Alain Ehrenberg. Il n'est donc pas prêt de revenir".
Je ne saisis pas si la dernière phrase évoque un constat ou un motif de satisfaction personnel? De plus,au risque de vous contrarier, les enseignants ont été malheureusement extrêmement "bien formés" à la pédagogie constructiviste dans les IUFM (fort heureusement supprimés depuis peu) et sont devenus hélas "très compétents" dans ce domaine!
L'exigence contemporaine d'autonomie serait donc incompatible avec les "bonnes vieilles" valeurs républicaine (expression qui connote un certain dédain...). On ne pourrait donc pas former un futur citoyen à la fois éclairé et autonome? Les exemples sont pourtant monnaie courante : des individus autonomes, responsables, libres de leurs choix et par ailleurs adhérant totalement aux valeurs de la République, d'autorité ,de travail et de mérite. De plus, vous évoquez un dépassement des oppositions en terme de pédagogie. Dans quelle mesure? A quelle forme de pédagogie faites vous allusion? L'opposition constructivisme-transmission est patente et demeure un casse tête quotidien pour les enseignants. Quelle forme de transmission des savoirs proposez vous?
le vendredi 23 novembre 2012 à 14:05
Depuis que j'ai spécifié la différence entre le constructivisme épistémologique et ses applications diverses, tu fais mine de l'avoir toujours su. Et tu précises que tu t'attaques à une seule des formes de constructivisme. Soit.
Mais alors, que fais-tu sur ce blog? Que fais-tu ici à vouloir décrédibiliser le constructivisme pour mieux décrédibiliser la Méthode Lafay?
Soyons logiques : si tu savais ce qu'est vraiment le constructivisme, et ce qu'est précisément le constructivisme "scolaire", tu aurais vu d'emblée que mon propos est différent, et donc tu n'aurais pas attaqué sur ce point.
Quel serait l'intérêt, effectivement, d'attaquer le constructivisme "scolaire", sur un site qui n'y fait pas référence?
Ce n'est possible que s'il y a confusion (entre les applications du constructivisme), incompréhension (de la Méthode Lafay et des textes du blog), et intention (de nuire).
La manière dont tu t'embourbes montre bien l'étendue de tes limites culturelles, que tu revendiquais d'ailleurs fièrement dans un de tes premiers commentaires (sous un autre article).
Si tu maîtrisais (vraiment) ton sujet, tu aurais pu établir des comparaisons entre mon travail et le constructivisme pédagogique que tu veux (que tu essaies bravement de) dénoncer, et tu aurais vu que le rapprochement n'est pas pertinent.
Tu n'aurais donc pas attaqué sur ce point.
Le problème n'est pas l'ignorance. Mais le manque d'humilité et le mensonge quant aux savoirs qu'on ne possède pas. Forcément, si l'on veut débattre de sujets dont on ignore tout, le peu que l'on va apprendre en surfant rapidement sur le net ne permettra pas de faire illusion bien longtemps, car on se prend inévitablement les pieds dans le tapis face à des interlocuteurs qui maîtrisent ces sujets. Très vite, les "raisonnements" montrent leurs faiblesses.
le samedi 24 novembre 2012 à 11:59
Très bon article, merci Raphaël !
Merci aussi à Pilou-Pilou pour les réponses très instructives qu'il provoque en jouant le clown.
Raphaël, loin de moi l'idée de faire du prosélytisme, mais j'exerce le métier d'étiopathe (thérapie manuelle mécaniste peu connue) et les principes fondamentaux de l'étiopathie repose sur une déconstruction du modèle médical occidental actuel et une interrogation sur l'épistémologie de la médecine. Le fondateur de cette discipline a élaboré une théorie globale de la pathologie s'appuyant sur la systémique et la cybernétique. Elle permet de résoudre un grand nombre de troubles fonctionnels de manière efficace, en considérant l'homme comme un système vivant et en s'intéressant aux interrelations entre les différents sous-systèmes (les organes) qui le composent. L'efficience étant le but ultime de tout étiopathe mais pas si facile à atteindre (si j'ai bien compris la nuance entre les deux termes).
Cette théorie repose sur un modèle déterministe des systèmes vivants et notre objectif est d'établir une relation de causalité entre les symptômes décrits par le patient et son organisme. Les sciences de l'observation médicales (anatomie, physiologie et clinique) forment donc le socle de notre enseignement en plus de l'apprentissage de techniques de manipulation et les principes fondamentaux qui forment le cadre de notre conception du vivant.
Si tu t'intéresses à la finalité de la médecine occidentale, j'ai en ma possession plusieurs textes (un brin subversifs) qui pourrait t'intéresser si tu le souhaites. Où l'on parle notamment du rôle social de la médecine et du rôle de thaumaturge du médecin, de l'impasse actuel de la science médicale, de la classification des phénomènes pathologiques ou encore de la logique et de la pensée médicale.
Olivier, tu avais mentionnée, il y a quelques temps, un projet d'article nommé "Constructivisme VS déterminisme", est-il toujours dans les cartons ? Je suis toujours aussi intéressé par cette opposition que tu fais entre les deux concepts et tu en connais maintenant la raison (cf ci-dessus). :)
le samedi 24 novembre 2012 à 15:31
Merci beaucoup pour ta proposition Black-Sun :-)
Peux-tu me faire parvenir ces documents à l'adresse mail suivante : carloproteosystem@hotmail.fr ?
Olivier te fournira une réponse plus complète et détaillée que la mienne, mais si tu envisages le monde de façon systémique, il est malaisé d'avancer une explication déterministe des phénomènes.
Un exemple : si un de mes patients présente un tableau de souffrance cérébrale, je ne pourrais pas en déduire immédiatement la cause qui est à l'origine de cette souffrance. En effet, étant donné que tous les organes sont liés (systémique), cette souffrance peut très bien provenir d'un dysfonctionnement hépatique, pulmonaire, cérébrale, ou, pourquoi pas, psychique, si l'on considère que le corps et l'esprit sont liés.
le samedi 24 novembre 2012 à 16:36
Bonjour à tous. J'ai lu les commentaires publiés, et ai très rapidement regardé en quoi consistait les travaux de Meirieu. Je suis notamment tombé sur ce texte.
meirieu.com/ACTUALITE/rea...
Il me semble avoir trouvé dans ce texte des éléments déjà écrits sur ce blog. L'Ecole qui n'est plus un lieu de culture , mais un lieu de compétition qui normalise. C'est à dire qu'il faudrait repenser la finalité de l'Ecole.
J'ai aussi l'impression que dans ce texte, l'auteur tisse un lien fort entre l'Ecole et le système social dans lequel évolue l'individu.
Ce qui me parait être un " bon" point, par rapport à ce qui s'est dit ici.
Je ne connais par contre pas les solutions qu'il propose, et la façon dont il les envisage.
Spooner, ou Olivier, pourriez vous m'expliquer pourquoi vous êtes en désaccord avec Meirieu, si vous en avez le temps ( et si vous etes vraiment en désaccord)?
En vous remerciant.
le dimanche 25 novembre 2012 à 12:40
@Black-Sun : Voici un document qui compare brièvement le Positivisme et le Constructivisme.
ygourven2.free.fr/webcom/wanadoo/epistemo.pdf
le dimanche 25 novembre 2012 à 22:53
Il est en effet difficile d’avoir une conception déterministe des systèmes vivants et encore plus des systèmes vivants malades car plusieurs contraintes s’opposent à un tel modèle. Les deux contraintes principales, à notre humble avis, sont, premièrement, la complexité des organismes vivants envisagés en tant que système de systèmes (avec une complexité croissante pour les systèmes vivants déviants « malades ») et deuxièmement, la variation morphologique entre les différents individus d’une même espèce.
Cette dernière contrainte empêche les généralisations hâtives qui permettraient d’appliquer le même traitement à mille patients différents présentant des symptômes semblables.
Néanmoins, en posant plusieurs axiomes (ça serait trop long à développer), il est possible de créer un modèle mécaniste du vivant basé sur un déterminisme simple. Cette conception débouche sur une théorie générale de la pathologie délimitant un cadre stricte dans lequel l’étiopathie peut intervenir de manière efficace. L’efficience, s’acquière, elle, avec l’expérience. :)
En paraphrasant Watzlawick citant Von Foerster, nous pouvons dire que la science ne se soucie d’ailleurs plus d’établir la vérité mais de produire des modèles efficaces/efficients d’action sur le monde. L’exemple le plus pertinent de ce genre de modèle est la méthode de musculation d’Olivier mais il y en a d’autres.
Prenons un individu humain considéré comme un système de systèmes ouvert sur son milieu extérieur, effectivement les interactions entre tous les organes sont multiples et incriminer tel lésion anatomique dans l’origine d’un ensemble de symptômes présentés par le malade peut paraître impossible. En fait, il faut bien comprendre que les interactions entre différents organes sont déterminées par la structure anatomique qui met en relation ces organes.
C’est le concept biologique de structure-fonction qui entre ici en jeu, à une structure anatomique donnée correspond forcément une fonction donnée. En pathologie, la modification de la structure entraînera inévitablement une modification de la fonction. L’inverse se vérifie aussi.
Illustrons notre propos par un exemple du domaine de la physiologie : l’arc-réflexe des barorécepteurs. Situés au niveau du sinus carotidien et de la crosse de l’aorte, ces systèmes barorécepteurs ont pour fonction d’informer en temps réel le tronc cérébral (centre nerveux cardiovasculaire) des variations de la pression artérielle. Toute variation anormale de la pression artérielle sera donc communiquée par la voie nerveuse au tronc cérébral qui ajustera le débit cardiaque et la résistance vasculaire systémique totale en agissant sur le cœur et la circulation périphérique. Cette action aura pour effet de diminuer ou d’augmenter la pression artérielle jusqu’à sa valeur normale.
Ce rétro-contrôle négatif (sous la forme classique : récepteur => voie afférente => centre intégrateur => voie efférente => effecteur) est un exemple parmi tant d’autres des mécanismes d’auto-régulations des systèmes vivants. Tous ces mécanismes, mettant en jeu différents systèmes, sont des processus déterminés par la structure anatomique spécifique de chacun d’entre eux.
Bien sûr, plus il y aura de systèmes en interrelation dans la réalisation d’un mécanisme plus celui-ci sera complexe. Il nous sera alors difficile d’en prévoir le comportement mais cela ne signifie pas qu’il se produise ex nihilo, sans raisons. L’ensemble des systèmes en jeu dans ce mécanisme restent des structures anatomiques et leurs interactions sont matérialisées par d’autres structures anatomiques. Ainsi, l’ensemble des systèmes qui composent un organisme et l’ensemble des interactions entre ces mêmes systèmes sont entièrement déterminés par leurs structures particulières. Et la complexité qui en résulte est secondaire aux limites des fonctions cognitives de l’être humain, incapable de saisir la chaîne de causalité qui, d’une cause donnée, a entraîné une myriade d’effets.
Pour autant, la stimulation de structures semblables chez des individus semblables (de la même espèce), prises dans des conditions semblables, produisent des effets semblables.
Si nous excitons le tendon quadricipital gauche d’une centaine d’individus, nous obtenons un réflexe de contraction musculaire chez la quasi-totalité des individus (les cas d’échec tenant plus de la mauvaise exécution du geste et de la morphologie particulière de certains sujets que d’un argument contre le déterminisme appliqué aux systèmes biologiques).
D’ailleurs, permettez-nous d’effectuer un petit parallèle avec le protéo-système. Cela n’engage que notre vision personnelle de la méthode Lafay. Il nous semble que bien qu’elle trouve ses fondements profonds dans le constructivisme, la méthode soit aussi influencée par le principe de causalité. La formule « méthode de musculation universelle personnalisable » illustre cette idée.
D’une certaine façon, l’agencement des exercices de la méthode en différents niveaux de difficulté croissante découle d’un modèle déterministe.
En effet, elle propose à tous les individus humains (homme ou femme) de changer leur corps en profondeur en suivant les instructions de la Méthode. Une fois la distinction faite entre les deux sexes (deux méthodes), il faut donc accepter que les individus de même sexe soient semblables.
Cette similitude va également se retrouver dans l’exécution des différents exercices d’un même niveau qui sont établis selon un protocole très clair et que chaque pratiquant devra respecter rigoureusement s’il veut obtenir des résultats. Nous avons maintenant notre « Méthode de musculation universelle », c’est-à-dire applicable par tous pour transformer son corps. Il nous faut maintenant aborder le thème de la personnalisation.
La notion de similitude est importante car c’est elle qui permet l’application d’un modèle déterministe à la musculation. Si nous appliquions la notion d’égalité entre les individus, le système serait directement invalidé à la vue des résultats inégaux obtenus. Car, les effets de l’entraînement sont fonction d’un certain nombre de paramètres propres à chaque individu. Il y en a qui dépendent directement de lui, son hygiène de vie (sommeil, alimentation, étirements…) , sa motivation ; et d’autres non, son histoire (âge, passé sportif, somme pathologique, potentiel génétique…).
Du fait de cette grande variété de pratiquants, des effets semblables produits dans des conditions semblables sont soumis à variation (dans une certaine fourchette). C’est pour cela que le protéo-système est si souple. Il permet, sur la base d’un cadre déterminé par la biomécanique humaine et les protocoles d’entraînement au poids du corps, d’optimiser les résultats sur le physique d’individus qui ne peuvent être que semblables, non égaux.
Les résultats ne sont pas les mêmes entre un individu de 50 ans et un autre de 20 ans, le chemin ne sera pas le même entre deux débutants, l’un obèse, l’autre maigre. Ou encore entre un sportif et un sédentaire, etc… C’est cette variété qui est prise en compte dans le terme « personnalisable ». Chaque individu aura les outils pour adapter « sa » méthode de musculation universelle à son vécu. Il pourra ainsi « rentabiliser » chacun de ses entraînements en l’adaptant à la situation du moment pour obtenir le plus d’effets possibles. Les effets pourront mettre plus de temps à apparaître, mais ils seront là, semblables à ceux d’un autre individu plus rapide.
Voilà pour une certaine vision du protéo-système sous un angle déterministe.
Olivier, pourrais-tu donner ton avis sur cette interprétation personnelle de la Méthode ou me dire si je travaille clairement du chapeau, s’il te plaît ? :)
Rods, merci pour la référence, je vais imprimer ça et le lire dès que j’en aurais le temps.
Raphaël, je suis curieux de savoir comment, sous l’angle des théories constructivistes, tu as pu modifier ton apprentissage de la médecine (changement superficiel) et/ou envisager une refonte de la finalité de la médecine (changement profond) ? :)
le lundi 26 novembre 2012 à 15:03
Je détaillerai tout cela dans un prochain article :-)
le lundi 26 novembre 2012 à 16:47
Salut, tout d'abord merci pour cet article qui explique, assez clairement je trouve, l'utilité concrète du constructivisme dans la vie de tous les jours ; et qui montre que cela peut s'appliquer effectivement à toute action que nous entreprenons.
De la même manière que toi, j'ai moi même remis en question mes méthodes de travail en médecine à l'approche des ECN, dans un objectif de performance, mais aussi pour rechercher l'efficience et pouvoir avoir une vie plus équilibrée que la plupart de nos congénères en mode "bêtes de concours", car je n'ai jamais réussi à sacrifier ma vie sociale, sportive, et mes loisirs sur l'autel de l'élitisme que tu décris, très présent dans nos études.
Je serais très intéressé de savoir quelles pistes de réflexions tu as menés au niveau des changements superficiels, et du reste. Je fais moi-même quelques expériences et je serais ravi de pouvoir échanger avec toi sur le sujet.
À plus !
le mardi 27 novembre 2012 à 14:10
Hello Thomas, je serais également ravi d'en discuter avec toi. Comme je l'ai dit plus haut, je suis en train de rédiger un article où j'essaie de synthétiser la compréhension que j'ai actuellement des relations entre Constructivisme et médecine. Nous pourrons donc en discuter à cette occasion ;-)
A bientôt !
le mercredi 19 décembre 2012 à 09:03
Est-ce que la notion de structure ne serait pas "conventionnelle", en tant que présupposé (cf Siegfried Schmidt et Hegel) commun nécessaire à une pratique du monde commune? Ne serait-on pas amenés à parler de structure de par notre extrême difficulté à envisager les processus?
La structure apparente de la Méthode n'est là que pour libérer le processus, que pour apprendre au pratiquant à sentir et vivre le processus (à s'accorder à lui). Ce n'est pas évident dans le livre vert seul, qui est une transition entre notre univers culturel habituel et le monde du processus (où rien n'est figé, tout est mouvement et irréversible), mais cela le devient si l'on additionne le livre vert, le rouge et le blog.
Notons que l'on peut structurer, organiser, sans que ce soit strictement relatif à l'acception "classique" du terme structure. Le "processus" consistant à ne voir que des relations, pas de formes fixes, on peut structurer (organiser) notre analyse du processus, notre rapport au processus, sans "figer" en catégories réduites au maximum.
Notre terminologie et nos regards habituels sont certainement, en ce cas, le reflet de notre impuissance à "parler selon le processus".
Qu'en penses-tu?
le vendredi 11 janvier 2013 à 12:33
Au sujet de l’opposition entre constructivisme et déterminisme – La structure et le processus.
Tout d’abord, je dois dire que je ne faisiais pas consciemment d’opposition entre la structure et le processus. J’ai donc cherché la définition de ces deux mots :
Structure : 1/ Manière dont les parties d’un tout sont arrangées entre elles.
2/ Organisation des parties d’un système qui lui donne sa cohérence et en est la caractéristique permanente.
3/ Organisation, système complexe considéré dans ses éléments fondamentaux.
Le terme structure est également employé dans de nombreux domaines de la connaissance comme nous le verrons plus loin.
Processus : 1/ Enchaînement ordonné de faits ou de phénomènes répondant à un certain schéma et aboutissant à qqchose.
(source : Larousse en ligne)
Ce qui me frappe de prime abord à la lecture de ces deux définitions, c’est cette notion commune d’ordre, d’organisation. Or, qui met de l’ordre dans son milieu extérieur ?
C’est l’homme. Qu’il observe un objet ou une suite de phénomène, l’homme procède à une découpe dans le réel et définit tel objet comme une structure, tel événement comme un processus. Nous extirpons de la réalité des amas de matière, nous les comparons à d’autres amas de matière, nous les classons par groupe, famille, catégorie, etc… à partir de leurs ressemblances ou de leurs relations. Puis, par induction, nous établissons des propositions par rapport à nos observations. Nous théorisons le réel tel que nous le percevons. Il en va de même pour l’énergie et depuis peu pour l’information.
Mais la réalité ou monde du processus ou monde en soi d’où nous faisons nos observations est lui en perpétuel mouvement vers l’entropie maximale. Une chose que nous avons déjà observé n’est déjà plus la même au bout de quelques heures.
Notre perspective d’être humain est affreusement limitée par notre petitesse et la brièveté de notre existence. Devant des processus qui se déroulent en silence sur des centaines, des milliers, des millions d’années, comment pouvons-nous en être les témoins en moins en quelques décennies d’existence ? Nous nous limitons donc à observer les changements directs de notre environnement car il en va de notre survie. Tout ce qui ne change pas sous nos yeux semble immuable parce que nous ne voyons pas les réactions qui se produisent.
Nous donnons donc une valeur d’immuabilité à de nombreux objets ou relations de notre environnement direct parce que nous ne pouvons faire autrement. Nous sommes conditionnés par nos sens et notre éducation.
Les connaissances transmises par la tradition orale puis la tradition écrite, qui constitue une part importante de notre « univers culturel habituel » nous permettent de relativiser cette pseudo-inertie de la réalité. Les observations qui ont été faites au fil des siècles de l’histoire de l’humanité nous font remarquer que les choses sont moins stables que nous ne le pensons (climat, catastrophe naturelle, histoire des civilisations, coutumes, traditions, techniques…).
De tous ces savoirs, certains sont à présent désuets ou obsolète mais nous continuons de les apprendre et les transmettre parce qu’elles n’ont pas été remises en cause. Nous avons été conditionnés. Ce que nous voyons de la réalité n’est qu’une image à travers le prisme de nos sens et de notre éducation (domestication ?).
La notion de structure, en tant que présupposé commun nécessaire à une pratique du monde commune est donc purement « conventionnelle ». Nous sommes des animaux sociaux, sans les autres nous n’existons pas. L’influence de notre milieu social nous apprend comment les choses doivent être et comment nous devons nous comporter. Les détenteurs du savoir nous transmettent des connaissances qui ont été codifié de génération en génération, c’est l’expérience commune des hommes qui les a poussés à établir des conventions, des référentiels. Telle chose sera un arbre, telle autre un chien, etc…
Néanmoins, devant la polysémie du terme structure, il peut paraître utile de clarifier les choses avant de continuer.
En effet, on parle de « structure » dans les sciences exactes (mathématiques, chimie) ; dans les sciences naturelles (biologie, géologie, géographie, pédologie) ; dans l’artisanat et l’industrie (architecture, pétrole, mécanique) ; dans les sciences sociales (anthropologie, économie, linguistique, psychologie, psychanalyse) ; dans les arts (musique).
A partir de ces groupes, nous pouvons définir deux catégories générales dans lesquelles ranger les structures. Il y a les structures concrètes et les structures abstraites. La catégorie des structures concrètes peut être à nouveau divisée en deux groupes. Le groupe des structures de la matière inanimée stable (un caillou, une chaise…) ou instable (les réactions chimiques…) et le groupe des structures « dynamiques » ou métastables qui comprend la matière vivante (animal ou végétal).
La catégorie des structures « abstraites » est constituée des constructions mentales élaborées à partir de la théorisation du réel.
Pour ce qui est de ma perception de la notion de structure, je fais donc une distinction entre les structures concrètes et les structures abstraites. Dans les deux cas j’ai bien conscience qu’il s’agit de construction de l’esprit humain mais la structure concrète a l’avantage d’être observable beaucoup plus aisément (à l’œil nu, au microscope, au téléscope…) alors que la structure abstraite est purement conceptuelle.
Je réserve donc le terme structure aux objets des sciences expérimentales.
Bien sûr, pour chaque structure que nous voulons étudier, nous pratiquons une dissection de la réalité et en retirant notre objet de son milieu naturel, nous le privons de certaines relations avec son niveau d’intégration supérieur et que nous ignorons peut-être. Si nous ignorons que le poisson respire uniquement en milieu aquatique et que nous le sortons de l’eau pour l’étudier, nous assistons impuissants à sa mort par asphyxie.
L’étude d’un objet ou d’un phénomène est donc toujours biaisée parce que nous coupons ses relations avec son milieu pour l’observer attentivement.
Pour en revenir à mon emploi du terme structure, je l’utilise dans son acception biologique, à savoir à travers le concept de structure/fonction. Cette conception a la particularité d’envisager les structures de manière dynamiques.
La structure est le siège d’un processus, mieux la structure est un processus.
La finalité d’un organe vivant est d’accomplir sa fonction tout en conservant son intégrité. La structure d’un organe est donc renouvelée en permanence au niveau tissulaire et moléculaire. Pour autant, le programme génétique du même organe entretient sa structure en vue de la réalisation de la fonction qui en découle. En 4 ans paraît-il, l’ensemble des molécules qui compose le corps humain s’est entièrement renouvelé sans qu’il nous semble avoir changé car les différents niveaux d’organisation qui nous composent gardent leur forme propre. Tant que rien ne vient les dévier.
Une structure biologique est donc en actualisation constante, elle renouvelle les éléments qui la composent tout en continuant d’assurer sa fonction en conservant sa forme spécifique.
Cela s’applique par les principes de la thermodynamique (Ilya Prigogine), la matière vivante est animée par le couplage de deux processus. L’un entropique entraîne les systèmes vivants à l’état d’équilibre « naturel », la mort ; l’autre, néguentropique maintient les systèmes vivants dans un état d’équilibre « métastable ». C’est ce processus néguentropique qui nous permet de croître, vivre et nous reproduire en échappant à notre mortelle condition pendant quelques décennies.
La résultante de ces deux processus est néanmoins majoritairement entropique et c’est pourquoi nous vieillissons inexorablement. Le vieillissement des systèmes vivants est donc un processus physiologique, non une maladie.
Pour conclure sur ma perception des notions de structure et de processus, je dirais que jusqu’à présent, je ne les opposais pas car je limitais l’emploi du terme « structure » aux objets de la science expérimentale. Dans ce cadre, il m’apparaissait normal, d’après les principes de la thermodynamique, que toutes ces structures étaient toutes sujet à l’entropie mais plus ou moins stables. Elles ne pouvaient donc être figées à jamais. Je constate donc que mon acception des deux termes n’était pas « classique ».
Mais face à ce monde du processus, comment ne pas être frappé de stupeur par autant de complexité ? Comment ne pas sombrer dans le scepticisme absolu face à la non-persistance de toute chose ? Comment continuer à ordonner la réalité pour agir de manière positive sur notre environnement ?
Dans ces termes, le principe de causalité semble inutile et le déterminisme est remisé au placard, surtout lorsqu’on veut l’appliquer aux systèmes vivants, tellement complexes !
Face à une telle problématique, il est intéressant de constater que le cheminement intellectuel du fondateur de l’étiopathie n’a pas été le même que celui du fondateur de la méthode Lafay. Bien sûr, les objectifs n’étaient pas les mêmes.
Pour le premier, il s’agissait d’établir une méthode visant à établir une relation de causalité entre les phénomènes pathologiques présentés par les systèmes biologiques et leurs structures. Un déterminisme simple était donc nécessaire et il fallait trouver un moyen de surmonter l’écueil du multi-déterminisme. Dans tous les cas, le patient reste un objet de la connaissance.
Pour le second, il s’agissait d’établir une méthode de développement personnel visant à émanciper ses pratiquants en les guidant vers toujours plus d’autonomie. Un cadre strict était nécessaire mais il n’en constituait que le point de départ. Le pratiquant n’est plus un objet comme dans le premier cas mais un sujet. Il est acteur de son développement.
La question que je me posais jusqu’alors était de savoir si ce cadre strict qui sert d’assise à la méthode Lafay utilisait un outil déterministe à l’intérieur d’une conception plus large, constructiviste Il me semble que tu réponds à la question dans ton commentaire précédent. Le livre vert établit donc l’ensemble des règles à suivre pour tout individu désirant se muscler. Le livre rouge et le blog sont là pour conduire chaque pratiquant à son autonomisation. On part du général d’un ensemble codifié d’exercices à suivre à la lettre au particulier d’une utilisation personnifiée de chaque exercice.
En fait, l’opposition entre constructivisme et déterminisme ne l’est que par rapport à une conception trop figée du principe de causalité ? Cette proposition qui affirme que « dans les mêmes conditions, les mêmes causes produisent les mêmes effets » sous-entend donc une égalité parfaite entre les objets étudiés. Ce qui rentre en contradiction avec la vision dynamique du monde réel telle qu’elle est envisagée par le constructivisme.
L’opposition se fait également au niveau de la question du câblage de l’univers. Toutes les choses sont-elles reliées entre elle indépendamment de notre perception ou est-ce nous qui mettons naturellement de l’ordre dans notre environnement en établissant des relations entre les objets et les phénomènes ?
Les constructivistes prennent le parti de dire qu’on ne peut trancher la question. Pour l’étiopathie, méthode et thérapie reposant sur un modèle déterministe, la réalité est un monde de processus « câblé » mais il est tellement complexe que l’esprit humain seul est impuissant à embrasser toutes les relations qui le composent. Nous autres étiopathes, nous avons une vision laplacienne du déterminisme. Nous nous limitons donc à établir un modèle déterministe simple le plus à même de nous permettre d’agir positivement sur notre environnement.
le samedi 12 janvier 2013 à 12:31
Eh bien, tu m'avais dit que tu allais potasser le sujet, je vois que tu n'as pas fait les choses à moitié ;-)
Je me permets, dans un premier temps, de recentrer la conversation autour de la notion d'autonomie, quitte à développer par la suite.
Lorsque l'on ouvre le livre vert, on découvre une séquence de niveaux et d'exercices (un ordre) figée dans le papier et qui semble donc immuable. Au départ, le pratiquant doit suivre à la lettre ces recommandations, sa conduite est donc déterminée, régulée de l'extérieur.
Puis, progressivement, à mesure qu'il s'approprie cette structure, il devient capable de la reconfigurer afin que celle-ci colle au mieux avec ses objectifs, sa progression et ses contraintes sociales. Il devient donc autonome, c'est lui qui régule sa propre pratique (auto-régulation).
En somme, passer de la structure au processus (système ouvert sur son environnement) c'est passer de la régulation (déterminisme) à l'auto-régulation (autonomie).
PS : je me contente de reformuler ce que tu expliques dans ton commentaire et ce qu'Olivier a déjà expliqué dans l'article "le chemin se construit en marchant" du 09/08/2011.
Je vais réfléchir à un élargissement de tout cela au niveau de la relation culture/individu et je reviendrai poster sous peu :-)
le dimanche 13 janvier 2013 à 03:09
Raphaël, pourrais-tu préciser la distinction que tu fais entre le déterminisme et l'autonomie. Est-ce que, selon toi, un système auto-régulé n'est pas déterminé comme un système régulé peut l'être ?
Est-ce que l'émancipation offerte par la pratique de la méthode Lafay nous affranchi entièrement de la double influence de notre milieu et de notre potentiel génétique ?
Ou n'est-ce pas plutôt un moyen d'actualiser au mieux notre potentiel génétique en nous offrant toujours plus de possibilités pour réagir face aux contraintes du milieu extérieur ? (Cf La stratégie de la motivation d'Olivier)
J'ai là le discours d'un idéologue car la question se révèle être une aporie si j'ai bien compris le point de vue constructiviste.
Ce dernier consiste à dire q'une application absolue du déterminisme est un ouroboros, un serpent qui se mord la queue.
En effet, considérer que l'ensemble de la réalité est déterminée, c'est considérer que nous autres, êtres vivants, sommes également déterminés par les différents systèmes qui composent notre organisme. Nous ne sommes donc jamais plus que ce que notre potentiel génétique actualisé nous permet d'être (notion d'émergence mise à part). Ce que nous percevons alors de notre environnement est déterminé et, par extension, les constructions mentales que nous élaborons le sont aussi. Donc notre conception déterministe du monde est déterminée.
La boucle est bouclée, nous pensons avoir trouvé la solution à tous nos problèmes, l'ultra-solution mais, en vérité, la nature de la réalité est insondable. Nous émettons donc un dogme.
Malgré tout, ce noeud gordien me semble tranchable d'un bon coup d'épée. Il faut accepter que le déterminisme absolu n'est qu'une doctrine philosophique de plus conduisant inévitablement au fatalisme.
A travers une utilisation restreinte, le déterminisme présente néanmoins l'avantage d'être utilisable dans des champs d'observations précis de la science. Il devient un outil qui permet de réifier le réel. On crée alors des modèles nous permettant d'agir de manière efficace sur notre environnement.
Il y a peu, je pensais encore que la méthode Lafay répondait à ce dernier procédé (une conception constructiviste et un outil déterministe à son service) mais la chose me paraît maintenant encore plus subtile. Je constate que ma vision des choses change progressivement. Tout semble être dans le rapport établi entre une science et son champ d'étude. Soit ce dernier est un objet, il est passif ; soit c'est un sujet, il est actif.
Or réifier la réalité d'un sujet se révèle être beaucoup plus complexe que réifier celle d'un objet. Car en tant que sujet, il réagit à son statut "d'objet d'étude".
Bien sûr, il est possible de justifier les comportements du sujet sous un angle déterministe mais on retombe inévitablement dans le cercle infernal du serpent qui se mord la queue. On paralyse alors l'action. La même action qui est la clé du changement dans la méthode Lafay.
Voilà qui amène de l'eau à mon moulin.
Yann ou comment mettre à profit une insomnie.
le mardi 15 janvier 2013 à 22:43
Yann, je dirais qu'un système est régulé lorsque sa conduite est réglée par un agent extérieur, en fonction de buts qui lui sont propres.
Par exemple, lorsqu'un pratiquant désireux de se muscler pousse la porte d'une salle de musculation, il va mettre en oeuvre des programmes qui ne correspondent probablement pas à ses objectifs initiaux, mais qui vont lui imposer de l'extérieur leurs propres objectifs (culte du corps, culte du héros).
La Méthode est aussi un programme culturel, sauf que ce programme ne reste pas "extérieur" au pratiquant bien longtemps. Celui-ci se l'approprie progressivement, jusqu'à réguler lui-même sa propre pratique en fonction de buts qu'il aura lui-même établie (auto-régulation).
Est-ce que ça te semble plus clair comme cela ?
le vendredi 25 janvier 2013 à 15:38
Raphaël : Je vois ce que tu veux dire.
Ca me fait penser à la Nouvelle Grille d'Henri Laborit.
L'individu est composé de différents niveaux d'organisation et rentre lui-même dans un niveau d'organisation plus grand. Une des problématiques de son ouvrage est la suivante :
Chaque niveau d'organisation qui compose un individu est auto-régulé pour assurer sa pérennité (notion de servo-mécanisme : chaque niveau d'organisation supérieur régule le niveau sous-jacent). C'est quand on passe au niveau d'organisation supérieur à l'individu - le cercle familial et privé, le cercle professionnel, la région, le pays, etc... - que l'auto-régulation propre à la pérennité de l'individu disparaît.
A partir de ce stade, soit le niveau d'organisation supérieur à l'individu ne permettra pas son épanouissement optimal, soit il le permettra.
En caricaturant à outrance, on peut dire que l'entraînement classique en musculation, de part son investissement requis en temps, en argent et en énergie est globalement néfaste pour le développement personnel du pratiquant. La régulation n'est pas optimal, elle est même aliénante.
La méthode d'Olivier, quant à elle, propose une pratique qui vise à l'émancipation des individus. C'est une pratique qui "subordonne la construction du corps à la construction de soi". Etape par étape, chaque pratiquant apprend ce qui est bon pour lui et l'intègre à son propre développement personnel. La régulation proposée conduit à l'auto-régulation.
Je vois donc que nous sommes d'accord. :)
Au passage, si tu ne connais pas encore Henri Laborit, je t'invite à le lire. Il a écrit beaucoup d'ouvrages vulgarisés très intéressants et beaucoup d'ouvrages spécialisés qui pourraient t'intéresser en tant que futur médecin, notamment un Traité de physiologie avec une approche cybernétique.
le samedi 26 janvier 2013 à 15:18
Merci pour tes conseils Black-Sun. Je connais Henri Laborit de nom + quelques unes de ses idées mais je n'ai pas encore pris le temps de me pencher sur ses ouvrages.
le samedi 26 janvier 2013 à 18:19
Je te préviens tout de même, c'est un déterministe pur et dur ! :)
le dimanche 27 janvier 2013 à 15:43
Ah ben dans ce cas, il peut toujours se brosser pour que je lise ses bouquins.
le dimanche 27 janvier 2013 à 16:23
:-D
le dimanche 27 janvier 2013 à 17:47
Olivier, évite de rigoler à mes blagues simplement pour me faire plaisir.
le dimanche 27 janvier 2013 à 21:17
A l'heure qu'il est, il s'en brosse déjà pas mal de son lectorat. :)